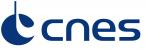Guillaume Bigourdan ( 1851 – 1932 ) et l’astronomie française
Introduction

Cette exposition est visible à Auvillar (Tarn-et-Garonne) du 14 juin au 30 août 1997.
A partir du 1er septembre 1997, les associations scientifiques et culturelles qui le souhaitent pourront louer cette exposition, composée de dix panneaux, de deux tableaux (les Pléiades et un exemple de la Carte du Ciel), de livres et documents sur Guillaume Bigourdan.
Pour tous renseignements, contacter :
Andrée Capgras, Avenue de Bordeaux, 82400 Valence d’Agen,
tel. 05 63 39 61 25
ou
Emmanuel Davoust, Observatoire Midi-Pyrénées, 14 Avenue Belin, 31400 Toulouse,
tel. 05 61 33 28 68
Réalisation
Cette exposition a été réalisée par Andrée Capgras, présidente de l’Association des Amis du Vieil Auvillar, et Emmanuel Davoust, astronome à l’Observatoire Midi-Pyrénées.
Cette exposition a pu être réalisée grâce à la participation de la Commission du Patrimoine de l’observatoire de Midi-Pyrénées qui a bien voulu accepter de diriger la partie scientifique, des descendants de Guillaume Bigourdan, ses petits enfants, Monsieur Le Monnier de Bruxelles, Madame Antoinette Diez de Paris, Monsieur Jean Bigourdan de Bordeaux, qui ont accepté de prêter des documents personnels ainsi que Madame Delthil d’Auvillar, la famille Pierre Mouchez de Paris avec qui nous avons eu de nombreuses discussions et Claude Mayousse, astronome amateur, qui a bien voulu prèter des livres de Guillaume Bigourdan.

Portrait de Guillaume Bigourdan
Guillaume Bigourdan est un astronome qui vécut à la fin du siècle passé et au début de ce siècle. La présente exposition retrace sa vie, de Sistels où il est né en 1851, à Toulouse en 1873, puis à Paris à partir de 1879, où il travailla avec acharnement jusqu’à la fin de sa vie en 1932, d’abord comme observateur à l’équatorial de la tour de l’Ouest de l’Observatoire de Paris, puis comme membre actif et plus tard président de l’Académie des Sciences, cumulant également la charge de directeur du Bureau International de l’Heure.
L’histoire de la vie de Guillaume Bigourdan, surnommé le bénédictin de l’Astronomie, est également l’histoire d’un siècle de l’astronomie française, l’observation des comètes, des nébuleuses, des petites planètes, les expéditions lointaines pour observer les éclipses de Soleil et les transits de Vénus. Ces deux histoires méritent d’être connues, car elles font partie de notre patrimoine.
Guillaume Bigourdan, les jeunes années

La maison familiale
La famille Bigourdan est vraisemblablement installée dans la commune de Sistels (Tarn et Garonne) depuis le XVllème siècle.
Elle possède une propriété au lieu dit « Tujague » non loin du village. La ferme comprend une grande et une petite habitation. Les cultures sont variées, des céréales, de la vigne, et de l’élevage, les bêtes sont utilisées pour le travail des champs.
Dans les années 1820, Guillaume Bigourdan épouse Geneviève Descamps et de cette union nait en 1826 Pierre. En 1848, Pierre Bigourdan épouse Jeanne Carrère née à Gaudonville, petit village du Gers à quelques kilomètres de St Clar. Ce jeune couple aura trois enfants, Guillaume né en avril 1851, Marguerite en 1853 et Sylvestre en 1857.
Dès l’âge de 7 ans Guillaume partage son temps entre l’école du village et l’aide au travail des champs. Issu d’une famille profondément catholique, il va au catéchisme et, comme l’instituteur, le curé remarque son intelligence. Il commence à apprendre le latin.
Alors sa famille en s’imposant de lourds sacrifices, l’envoie pensionnaire dans une école privée de Valence d’Agen (chef-lieu de canton à quelques dix kilomètres de Sistels). Le jeune Guillaume obtient d’excellents résultats et très régulièrement, il écrira à ses parents pour leur en faire part, car il connaît les sacrifices imposés. En 1870, il obtient son baccalauréat es-sciences avec mention « Assez Bien » à l’Université de Toulouse.
Guillaume Bigourdan à Toulouse (1873 – 1879)
Guillaume Bigourdan arrive à Toulouse en 1873. Il poursuit ses études à la faculté des sciences de l’Université de Toulouse. Il passe une licence de physique en 1874 et une licence de mathématiques en 1876. Pour financer ses études, il est professeur dans un pensionnat.
L’un de ses professeurs à l’université, Félix Tisserand, le remarque et lui offre de venir travailler à l’Observatoire où il début le 1er janvier 1877. Il est chargé des observations méridiennes. Il prend aussi part aux observations des satellites de Jupiter, des comètes et des taches solaires et à la recherche de petites planètes.
L’Observatoire de Toulouse à Jolimont
Pendant les 150 ans de son existence, l’Observatoire de Toulouse à Jolimont a réalisé un grand nombre de travaux astronomiques important, une collection de dix mille clichés de la Carte du Ciel, trois catalogues d’observations méridiennes de plusieurs milliers d’étoiles chacun, et trois catalogues astrophotographiques qui totalisent plus de 200 000 étoiles. Citons également la construction du télescope Benjamin Baillaud au sommet du Pic du Midi, qui a permis par la suite des observations uniques au monde. Enfin, les observations réalisées aux différents télescopes constituent de remarquables bases de données, sur les taches solaires, les étoiles doubles, les petites planètes, les satellites de Jupiter et de Saturne.

Vue de l’Observatoire à Jolimont au début du siècle
Lorsque Guillaume Bigourdan est astronome à l’Observatoire, il n’y a qu’un seul instrument important, le télescope de 83 centimètres de diamètre. Sur la photographie datant du début du siècle, on voit cependant de nombreuses coupoles. Elles abritent les instrument acquis sous la direction de Benjamin Baillaud.
— une lunette de Brunner avec un objectif de 25 centimètres d’ouverture, qui servira principalement à l’observation des étoiles doubles
— un équatorial double, type Carte du Ciel, avec un objectif photographique de 33 centimètres et un objectif visuel de 19 centimètres
Félix Tisserand, directeur de l’Observatoire de Toulouse
Félix Tisserand, normalien, astronome-adjoint à l’Observatoire de Paris, est nommé directeur de l’Observatoire de Toulouse en 1873, à l’âge de 28 ans. Contrairement à ses prédécesseurs, Tisserand n’est pas le seul astronome de l’Observatoire; deux aides-astronomes, Guillaume Bigourdan et Joseph Perrotin, l’assistent dans ses observations. Ce dernier, originaire de Pau où il a été en classe avec Isidore Ducasse (plus connu sous le pseudonyme de comte de Lautréamont), était maître répétiteur au Lycée de Toulouse.
En 1874, Tisserand part au Japon observer le transit de Vénus sur le Soleil. Pendant cette absence d’un an, Jules Gruey, chargé de cours à la faculté des sciences de Toulouse, futur directeur de l’Observatoire de Besançon, assure l’intérim de la direction.
En 1878, Tisserand quitte l’Observatoire de Toulouse pour prendre un poste de professeur à l’Université de Paris. Guillaume Bigourdan le rejoint le 1er novembre 1879, et Joseph Perrotin prend la direction de l’Observatoire de Nice en 1880.
Le télescope de 83 centimètres de l’Observatoire de Toulouse
Tisserand fait installer le télescope de 83 centimètres en 1875. La monture, en bois, n’est pas stable, et ne permet pas autre chose que des observations visuelles; de plus, le micromètre qui permettrait de faire des mesures de séparations d’étoiles doubles ne fonctionne pas.

Le télescope de 83 cm
Il ne reste plus qu’un seul programme possible, l’observation des satellites de Jupiter et de Saturne, tâche à laquelle se mettent les trois astronomes, Tisserand, Bigourdan et Perrotin. Ils font d’ailleurs si bien que Benjamin Baillaud, le directeur suivant, s’en servira pour établir une théorie des orbites de cinq des satellites de Saturne, théorie fort peu modifiée à ce jour.
Les trois astronomes observent également les taches solaires et les petites planètes.
Les petites planètes
La première petite planète, Céres, a été découverte en 1801 par l’astronome sicilien Piazzi. Par la suite, les astronomes du siècle dernier découvrirent de nombreuses petites planètes entre les orbites de Mars et celle de Jupiter. Lorsque Guillaume Bigourdan entre dans la compétition, plus d’une centaine ont déjà été découvertes, baptisées et cataloguées. Il s’agit à l’époque de faire leur inventaire et de déterminer les paramètres de leur orbite. le télescope de 83 centimètres de l’Observatoire de Toulouse est assez puissant pour ce genre d’observation. A l’heure actuelle, on désigne sous le nom d’astéroïdes ces petits corps du système solaire, dont on a dénombré plus de 4000. Maintenant, on s’intéresse surtout aux propriétés minéralogiques de ces petits corps.
Pendant longtemps, on a cru que les astéroïdes résultaient de la désintégration d’une planète primitive en orbite entre Mars et Jupiter. On pense maintenant au contraire que cet agglomérat de roches n’a jamais pu se condenser en une planète à cause de la présence de Jupiter.
Perrotin découvre une nouvelles petites planète le 19 mai 1874. Comme il est de tradition de donner des noms féminins aux petites planètes, il lui donne le nom de Tolosa. Guillaume Bigourdan en découvrira une dix ans plus tard, qu’il baptisera Alma.
Guillaume Bigourdan à Paris (1879 – 1932)
1879. Guillaume Bigourdan quitte Toulouse et va travailler à l’Observatoire de Paris à la demande du professeur Tisserand.
Juin 1882. Il participe avec Tisserand aux observations du passage de Vénus devant le Soleil à la Martinique. Dans une lettre écrite à ses parents sur le paquebot « Washington », il raconte ses impressions de voyage, s’inquiétant toujours de leurs problèmes.
En 1883, il part pour une mission à St Pétersbourg, s’arrête en Pologne à Cracovie, visite Berlin et Vienne en Autriche.
En 1885, à 34 ans, il épouse Sophie Mouchez, fille aînée de l’amiral Mouchez alors directeur de l’observatoire de Paris. Ils auront neuf enfants dont trois garçons. Il entre dans une famille bourgeoise mais son importante correspondance avec ses parents montre qu’il ne renie pas ses origines, et s’inquiète toujours de leurs problèmes.

Sophie et Guillaume Bigourdan au moment de leur mariage en 1885
En 1886, il soutient sa thèse de doctorat : « sur l’équation personnelle dans les mesures d’étoiles doubles ».
1893. Il dirige une expédition pour observer l’éclipse de Soleil du 16 avril à Joual (Sénégal). Il y détermine l’intensité de la pesanteur, mesure qu’il répétera en 1896 lors d’une expédition au sommet du Mont-Blanc.
1900. Il participe à l’observation de l’éclipse de Soleil du 28 mai, à Hellin (Espagne).
1902. Il participe à la mesure de la différence de longitude entre Paris et Greenwich (Angleterre).
En 1903, il est élu membre titulaire du Bureau des Longitudes et l’année suivante, membre de l’Académie des Sciences dans la section astronomie.
1905. Il participe à l’observation de l’éclipse de Soleil du 30 août à Sfax (Tunisie).
1907. A la mort de Maurice Loewy, directeur de l’Observatoire de Paris, il est candidat à sa succession. Mais il n’est pas sorti d’une Grande Ecole et c’est un catholique très pratiquant. On lui préfère Benjamin Baillaud.
En 1920 il est nommé officiellement premier directeur du Bureau International de l’Heure (B.I.H.) jusqu’en 1929 date de sa retraite.
En 1924, il est élu Président de l’Académie des sciences et l’année suivante Président de l’Institut de France.
En 1926, il prend sa retraite d’astronome à l’Observatoire de Paris
Il meurt à Paris le 28 février 1932, au 6 rue Cassini, dans l’appartement où il a pratiquement toujours vécu avec sa famille, tout près de l’observatoire. Ses obsèques auront lieu en présence de nombreux scientifiques, mais sans aucun représentant du gouvernement. Guillaume Bigourdan repose au cimetière Montparnasse.
En 1956, une plaque est apposée sur sa maison natale par la municipalité de Sistels, l’Académie de Montauban participe à cette manifestation et ceci en présence d’une partie de ses enfants.
L’observatoire de Paris et la Carte du Ciel
Il y a un peu plus d’un siècle commençait l’aventure de la Carte du Ciel, qui occupa tous les astronomes d’une vingtaine d’Observatoires dans le monde pendant près de cinquante ans. Le but de ce projet ambitieux était de photographier tout le ciel en 22054 clichés de 2×2 degrés chacun. Une tâche aussi importante ne pouvait pas être réalisée par un seul observatoire, et, de ce fait, la Carte du Ciel est l’un des premiers grands projets scientifiques faisant l’objet d’une collaboration internationale.
L’amiral Mouchez

L’Amiral Mouchez
L’homme à l’origine du projet de la Carte du Ciel est l’amiral Mouchez, directeur de l’Observatoire de Paris, et dont la fille aînée épousa Guillaume Bigourdan.
Ernest Mouchez est né en 1821 à Madrid, fils du perruquier du roi Ferdinand VII. Il entre à l’Ecole Navale et devient officier de marine. Il passe une grande partie de sa vie à faire de la cartographie marine.
En 1874, il participe à une expédition scientifique qui se rend à l’île Saint-Paul, dans l’Océan Indien, pour observer le passage de Vénus devant le Soleil. L’application de la photographie pour enregistrer les instants de contact entre la planète et le Soleil est un succès.
Il est nommé à la direction de l’Observatoire de Paris en 1878, à la mort de Le Verrier. Il ne tarde pas à comprendre que les progrès en photographie astronomique, en particulier ceux réalisés par les frères Henry à l’Observatoire de Paris peuvent révolutionner l’uranographie, ou cartographie céleste. C’est ainsi qu’il lance l’idée de cartographier tout le ciel par la photographie.
Le congrès de la carte du Ciel
Lorsque l’amiral Mouchez lance son projet en 1887, il est soutenu par David Gill, directeur de l’Observatoire du Cap de Bonne Espérance, et Otto Struve, directeur de l’Observatoire de Poulkovo, près de Saint- Pétersbourg. Le congrès de la Carte du Ciel, qui se réunit à l’Observatoire de Paris en 1887, étudie la faisabilité du projet. Bientôt ce sont 18 Observatoires, ceux de Paris, Bordeaux et Toulouse pour la France, qui acceptent de participer à cette entreprise.

Le congrès de la Carte du Ciel
Sur la photographie du congrès, l’amiral Mouchez est assis au centre, David Gill, avec une canne, est à sa droite, et Otto Struve, avec sa barbe blanche imposante est à sa gauche. Les frères Henry sont les deux barbus debout au dernier rang à l’extrême gauche de la photo. Benjamin Baillaud, directeur de l’Observatoire de Toulouse, est troisième à partir de la droite au dernier rang. Felix Tisserand, ancien directeur de l’Observatoire de Toulouse, et futur directeur de celui de Paris est le troisième astronome assis à partir de la droite.
|
Observatory |
N plaques |
Declinaison en degrés |
|---|---|---|
| Greenwich | 1149 | + 90 à + 65 |
| Rome | 1040 | + 64 à + 55 |
| Catania | 1008 | + 54 à + 47 |
| Helsinki | 1008 | + 46 à + 40 |
| Potsdam | 1232 | + 39 à + 32 |
| Oxford | 1180 | + 31 à + 25 |
| Paris | 1260 | + 24 à + 18 |
| Bordeaux | 1260 | + 17 à + 11 |
| Toulouse | 1080 | + 10 à + 5 |
| Algiers | 1260 | + 4 à – 2 |
| San Fernando | 1260 | – 3 à – 9 |
| Tacubaya | 1260 | – 10 à – 16 |
| Santiago | 1260 | – 17 à – 23 |
| La Plata | 1360 | – 24 à – 31 |
| Rio | 1376 | – 32 à – 40 |
| The Cape | 1512 | – 41 à – 51 |
| Sydney | 1400 | – 52 à – 64 |
| Melbourne | 1149 | – 65 à – 90 |

Implantation des différents observatoires
L’astrographe double de l’Observatoire de Paris
Cet astrographe double a été inventé par les frères Henry. Il est composé de deux lunettes de 30 centimètres de diamètre accolées, l’une, équipée d’un porte-plaque pour prendre les photographies, l’autre équipé d’un oculaire. Cette deuxième lunette permet à l’observateur de surveiller une étoile guide et corriger les défauts du mouvement du télescope pour que cette étoile reste bien au centre du champ de l’oculaire. Ainsi la difficulté de faire des poses longues sans que les étoiles ne bougent sur le cliché était résolue.
Tous les observatoires participant à l’entreprise de la carte du Ciel auront un instrument identique.
La photographie de l’amas des Pléiades par les frères Henry

Photographies récente de l’amas des Pléiades. Les étoiles jeunes sont encore entourées d’un cocon de gaz
En octobre 1885, les frères Henry utilisent leur astrographe pour obtenir un cliché de l’amas des Pléiades, après une pose de trois heures. On dénombre 1421 étoiles sur le cliché, un résultat prodigieux, sachant que, dix ans plus tôt, l’anglais Rutherford n’en comptait que 50 sur un cliché semblable, et la carte de cette région, qui demanda plusieurs années de travail à un astronome de l’Observatoire de Paris, n’en compte que 671.
C’est ce cliché qui décida l’amiral Mouchez à lancer son projet de Carte du Ciel.
Les dames de la Carte du Ciel

Les dames de la Carte du Ciel à Paris
Les observatoires employaient des femmes pour faire les fastidieuses mesures de positions d’étoiles. Comme dans beaucoup de domaines scientifiques, les femmes
constituaient une main d’oeuvre bon marché puisqu’elles n’avaient aucun espoir de pouvoir faire des études supérieures. Elles n’avaient pas non plus de statut permanent; l’observatoire les embauchait comme « calculatrices » ou « employées auxiliaires », rémunérées à l’heure ou à la journée.
En plus des mesures sur les plaques, les calculatrices de la Carte du Ciel devaient faire de nombreux calculs (à la main puisque les ordinateurs n’existaient pas) pour corriger les coordonnées mesurées des effets de l’atmosphère, et pour rapporter ces coordonnées au valeurs absolues données par les étoiles de repère observées avec une lunette méridienne.
Le catalogue astrophotographique
En complément de la Carte du Ciel, les astronomes ont décidé d’établir un catalogue astrophotographique. Il s’agissait de faire un catalogue de toutes les étoiles visibles sur les plaques, jusqu’à la magnitude 11, avec leurs coordonnées et leur magnitude. Cela représente environ 3 millions d’étoiles.
Le catalogue astrophotographique est produit en deux étapes, qui sont menées de front.
— D’une part, on mesure les positions d’étoiles de repère avec une lunette méridienne. C’est un travail long, mais précis; il faut mesurer l’instant de passage de chaque étoile au Sud, et sa hauteur au-dessus de l’horizon à cet instant.
— D’autre part, on mesure sur chaque plaque les positions relatives de centaines d’étoiles par rapport à ces étoiles de repère, qui généralement au nombre de 12 par plaque.
L’entreprise de la carte du ciel dura beaucoup plus longtemps que prévu, car on avait sous-estimé l’ampleur du travail à réaliser. A titre d’exemple, à l’Observatoire de Toulouse on prenait 400 à 500 clichés par an, et on mesurait les positions de 25000 à 30000 étoiles sur les clichés.
Guillaume Bigourdan : Le scientifique
Guillaume Bigourdan fut toute sa vie un observateur acharné. Dès le début de sa carrière, il se spécialise dans l’astronomie de position, c’est-à-dire la détermination précise des coordonnées des corps célestes, étoiles, nébuleuses comètes. Cela explique qu’il consacrera de nombreux travaux à l’amélioration des instruments d’observation et des méthodes de mesure de façon. Son but est d’obtenir des résultats avec le maximum de précision.
A partir de 1879, Il fait toutes ses observations astronomique à l’équatorial de la Tour de l’Ouest de l’Observatoire de Paris. Cet instrument est une lunette de 30,5 centimètres de diamètre et 5,25 mètres de longueur focale.
Son oeuvre principale est un catalogue des positions précises de 6380 nébuleuses. Il passa plus de 25 ans à faire ces mesures et découvrit plus de 500 nébuleuses nouvelles. Ce travail gigantesque publié en cinq volumes lui a valu une reconnaissance internationale, et, en particulier, la médaille d’or de la Royal Astronomical la Society de Londres en 1919.
Le but de ce travail était de fournir les données initiales pour déterminer les mouvements des nébuleuses.
Il observa également les comètes, les petites planètes qui sont en orbite entre Mars et Jupiter. En 1894, il découvrit une nouvelle petite planète, la 390 ème, qu’il baptisa Alma.
Son goût pour les recherches historiques le pousse à réaliser un important travail sur les astronomes français d’autrefois et les anciens observatoires, tant à Paris qu’en province. Il poursuivra ces recherches avec plus d’assiduité pendant la grande guerre, lorsque le démontage des télescopes précieux le forceront à abandonner sa coupole. A la fin de sa vie, il écrira une histoire du Bureau des Longitudes, dont il aura été un membre actif.
L’astronomie de position où il était passé maître lui donne une compétence toute particulière pour ce qui concerne les services de l’heure. Aussi, lorsque Paris sera choisi comme siège du Bureau International de l’heure, il sera nommé premier directeur de cet organisme en 1920, il le restera jusqu’en 1928.
Guillaume Bigourdan s’intéresse à de nombreux domaines de la science. Il écrit des articles sur :
– Le bruit du canon
– La météorologie, la sismologie
– Les cadrans solaires
– La disparition du moineau de Sistels. Ainsi n’avait-il toujours pas oublié son village natal. A la séance du 16 septembre 1918 de l’Académie des Sciences, il signale la disparition du moineau des campagnes d’une région où cet oiseau était abondant il y a peu de temps encore : Le point où a été faite cette observation est la commune de Sistels, située dans le Tarn et Garonne et contiguë aux départements du Gers du Lot et Garonne. Aucun changement de culture ne s’est produit récemment dans cette région.

Guillaume Bigourdan en tenue d’académicien
Au cours de sa carrière parisienne, Guillaume Bigourdan reçut de nombreuses distinctions :
1883 Prix Lalande de l’Académie des Sciences
1886 Prix Vals de l’Académie des Sciences
1891 Prix Lalande de l’Académie des Sciences
1893 Officier de l’Instruction Publique
1894 Prix Houlerique de l’Académie des Sciences
1895 Chevalier de la légion d’honneur
1900 Commandeur ordinaire de l’Ordre espagnol d’Isabelle la Catholique
1910 Grand Officier de l’Ordre de la Couronne royale de Roumanie
1919 Médaille d’or de la Royal Astronomical Society (Londres), pour son travail sur les nébuleuses
1919 Officier de la légion d’honneur
Les nébuleuses
L’oeuvre scientifique maîtresse de Guillaume Bigourdan est un catalogue de 6380 nébuleuse, dont plus de 500 nouvelles. Il observa de 1884 à 1911, soit pendant 27 ans de sa vie.
En 1911, on ne connaissait pas la nature des nébuleuses. On ignorait en particulier qu’une catégorie d’entre elles, les nébuleuses spirales, sont à des millions d’années-lumière de nous, et constituent des univers-îles, composées de centaines de milliards d’étoiles. La nature lointaine des nébuleuses spirales fut découverte par l’astronome américain Edwin Hubble en 1928. Il constata que ces nébuleuses s’éloignent de nous, d’autant plus vite qu’elles sont lointaines. Ce phénomène est dû à l’expansion de l’univers.
Les nébuleuses spirales
Lorsque nous levons les yeux vers le ciel étoilé par une belle nuit, nous apercevons une bande plus claire qui traverse le ciel, c’est la Voie Lactée.
La Voie Lactée est une galaxie, c’est-à-dire un système de plusieurs centaines de milliards d’étoiles. C’est en observant d’autres galaxies que nous comprenons comment est formée notre Voie Lactée.
Les galaxies spirales sont composées d’étoiles et de nuages de gaz qui ttournent rapidement autour d’un centre très massif, le bulbe de la galaxie, qui est souvent le siège d’un trou noir gigantesque. C’est la rotation rapide qui aplatit les galaxies en un mince disque. Ainsi, notre Voie Lactée est un disque d’étoiles vu par la tranche, puisque notre soleil et son cortège de planètes tournent à l’intérieur du disque.

La galaxie NGC 7741
La galaxie spirale NGC 7741, photographiée au télescope Bernard Lyot de l’Observatoire du Pic du Midi, est traversée d’une barre d’étoiles aux extrêmités de laquelle partent deux bras spiraux. Une telle barre se forme lorsque le disque d’étoiles a été perturbé, soit par le passage d’une autre galaxie, soit par un déséquilibre dans la répartition des étoiles.
Les nébuleuses planétaires

La nébuleuse planétaire NGC 7712
La nébuleuse planétaire NGC 7712, photographiée au télescope Bernard Lyot de l’Observatoire du Pic du Midi. L’étoile centrale, petit point blanc sur la photo, est une étoile naine blanche. C’est une étoile à la fin de sa vie. La température au centre de cette étoile n’est que d’un millions de degrés, contre dix millions au centre du Soleil. L’intérieur de l’astre n’est pas gazeux comme le Soleil, mais solide, à cause de l’énorme pression qui y règne (une tonne par centimètre carré). L’enveloppe gazeuse verte et rouge qui l’entoure s’est échappée de l’étoile, qui a ainsi perdu 10 à 20\% de sa masse. L’enveloppe va se dilater dans l’espace à la vitesse de quelques dizaines de kilomètres par seconde pendant environ cent mille ans. La couleur rouge témoigne de la présence d’hydrogène, alors que le vert est produit par de l’oxygène.
Les nébuleuses gazeuses

La nébuleuse Trifide
La nébuleuse trifide, dans la constellation du Sagittaire, se trouve à environ 5 milliers d’années-lumières de nous dans la direction du centre de la Voie Lactée. L’émission de couleur rouge est produite par l’hydrogène qui est excité par un petit groupe d’étoiles jeunes à l’intérieur du nuage gazeux. Ce nuage veiné de filaments de poussière sombre est en expansion et va former d’autres étoiles par compression du gaz. On aperçoit également une nébulosité bleue, qui réfléchit la lumière d’une étoile brillante.
Les nébuleuses obscures
Le nuage de Rho Ophiucus est un nuage sombre à quelques cinq cent années-lumière de nous, contient beaucoup de poussière, mais surtout un très grand nombre de molécules diverses. On estime que ce nuage contient au moins dix mille molécules d’hydrogène par centimètre cube. C’est au coeur de tels nuages que se forment les étoiles. Dix pour cent du nuage s’est déjà condensé en étoiles.
Guillaume Bigourdan : l’homme
Guillaume Bigourdan est un homme du peuple, élevé dans la religion catholique. Jamais il ne s’en éloignera. Bien qu’arrivé aux sommets de la hiérarchie scientifique, il conservera tout au long de sa vie les qualités des hommes de la terre.
Son intégrité absolu, sa modestie, le mépris pour le faux, le vain, le superficiel sont certes un reproche vivant pour bon nombre de personnalités au pouvoir à cette époque là.
C’était un homme intransigeant, un travailleur infatigable. Le général Bourgeois écrira dans le Bulletin de la Société Astronomique de France qu’il était : « le Bénédictin de la Science … Mais il s’enfermera dans la science comme dans une tour sans jamais vouloir admettre que si travailler pour l’astronomie est faire un noble emploi de sa vie, travailler à en répandre les résultats n’en est pas moins nécessaire ».

Guillaume Bigourdan, sa mère et son frère Sylvestre
A la fin de sa carrière il n’observera plus, ses lieux de prédilection seront la Bibliothèque de l’observatoire et celle de l’Institut.
Courtois , affable, travailleur solitaire défendant énergiquement son point de vue Guillaume Bigourdan a été tout dévoué à la Science.
Il ne néglige pas pour autant sa vie familiale et lorsqu’il part en mission il écrit régulièrement à son épouse, demandant des nouvelles des enfants et lui faisant part de ses travaux, des difficultés et des réussites, mais toujours avec le souci d’employer au mieux ce temps précieux, et les dépenses engagées.
Dans un de ses articles de journal de l’époque il dit détester la terre, il est cependant fort attaché à ses racines, et il entretiendra avec ses parents tout au long de leur vie une correspondance régulière.
Avec ses premières économies de célibataire, il a alors 31 ans, il fait construire à Tujague une maison de quatre pièces à étage. Cette maison jouxte la ferme dont la partie habitation est vraisemblablement petite et vétuste.
Plus tard, héritier de la propriété paternelle il n’a de cesse jusqu’à la fin de ses jours d’acheter des terrains de manière à agrandir le patrimoine familial.
Jusqu’en 1913, toute la famille Bigourdan vient en vacances à Sistels, on a même les cousins Mouchez. A partir de cette date, la guerre, l’environnement parisien font que son épouse, ses enfants ne viendront plus à Tujagues. L’on s’ennuie dans cette ancienne ferme, en pleine campagne ; Guillaume Bigourdan viendra seul tous les étés passer quelques semaines. Pendant ses séjours, il s’occupera de faire cultiver ses terres, ira voir ses anciens camarades de classe et parlera avec eux uniquement en occitan, même s’il fait une leçon d’astronomie.
Par les belles nuits d’été, il s’installera dans le pré devant la maison neuve de Tujague et continuera à observer les étoiles…
Les transits de Venus sur le Soleil
Peu de phénomènes prédictibles sont aussi rares que le passage de Vénus devant le Soleil. Il se produit environ deux fois par siècle, à 8 ans d’intervalle. Au sicèle dernier, il s’est produit en 1761 et 1769, puis en 1874 et en 1882, et il ne se produira pas avant l’an 2004, puis en 2012.
Les astronomes des siècles passés ont établi des collaborations internationales et monté des expéditions lointaines pour déterminer ces instants avec la plus grande précision possible. Guillaume Bigourdan participa à l’une des expéditions de 1882.
Pourquoi déployer tant d’énergie pour cela? Les transits de Vénus sont en fait le moyen le plus précis de déterminer la distance de la Terre au Soleil, et, de là, l’échelle des distances dans le système solaire.
En effet, dans le passé, on connaissait avec une grande précision les distances relatives dans le système solaire, grâce aux lois de Képler. Cependant, on ne pouvait pas les donner en kilomètres, mais seulement en fonction de la distance de la Terre au Soleil.
Les transits de Vénus
C’est le célèbre astronome Edmond Halley qui, en 1691, eut l’idée de déterminer la distance de la Terre au Soleil. La méthode fut améliorée un siècle plus tard par l’astronome français Jean-Nicolas Delisle.
Les dates des transits
| 7 décembre 1631 | 6 juin 1761 | 9 décembre 1874 | 8 juin 2004 |
| 4 décembre 1639 | 3 juin 1769 | 6 décembre 1882 | 5 juin 2012 |
La goutte noire

Vénus passe devant le disque solaire
La principale difficulté de mesurer avec précision l’instant où la planète Vénus quitte le bord du Soleil est dû à la formation d’une goutte noire dans le télescope. C’est une sorte de liaison entre le disque noir de la planète et le bord du Soleil qui se prolonge alors que la planète est déjà toute entière visible sur le disque solaire. Cette goutte noire est produite par la diffraction dans le télescope et par l’atmosphère de la planète, dont les astronomes ignoraient l’existence.
Les expéditions du 18ème siècle
C’est en 1761 que les astronomes du monde entier déterminèrent pour la première fois la distance de la Terre au Soleil en, observant le transit de Vénus. L’Académie Française envoya Alexandre Pingré à l’île Rodriguez dans l’Océan Indien et Le Gentil à Pondichéry. Malheureusement, quand ce dernier arrive à destination, la ville et aux mains des anglais et il ne peut pas débarquer. Il retourne à l’île Maurice mais y arrive trop tard. Il décide d’attendre 8 ans, mais la malchance le poursuit, car, en 1769, il fait mauvais à Pondichéry.
L’Académie de Saint-Pétersbourg envoie l’astronome français Chappe d’Auteroche en Sibérie. Celui-ci observe le transit de 1769 en Californie où il meurt de fatigue et de maladie peu après.
C’est Jérôme de Lalande qui fut chargé de rassembler les observations de tous les astronomes et d’en déduire la distance de la Terre au Soleil. mais les mesures individuelles étaient très différentes et cette distance ne put pas être déterminée avec précision. Il fallu donc se résigner à attendre un siècle.
L’expédition de Jules Janssen au Japon en 1874

Le revolver de Janssen
Jules Janssen, directeur de l’Observatoire de Meudon, alla observer le transit de Vénus de 1874 au Japon. Il était accompagné de Félix Tisserand, directeur de l’Observatoire de Toulouse. Il avait mis au point un revolver photographique permettant de prendre douze photographies en succession rapide, pour fixer l’instant par ce moyen l’instant exact du contact apparent entre la planète et le Soleil.
L’expédition de Félix Tisserand à la Martinique en 1982
Félix Tisserand, alors professeur d’astronomie à la Sorbonne et astronome à l’Observatoire de Paris, alla observer le transit de Vénus de 1882 à la Martinique; Il était accompagné de Guillaume Bigourdan. C’est lors de cette expédition lointaine que le frère de Guillaume Bigourdan mourut de la fièvre typhoïde.
La distance de la Terre au Soleil
Les résultats des expéditions du 19ème siècle furent aussi décevantes que celles du siècle précédent, et ce n’est que dans les années 1960 que l’on connut avec précision cette fameuse distance, par l’écho d’ondes radar envoyées de la Terre vers Vénus. Cette distance est de 149 millions de kilomètres.
Le role des astronomes
A quoi servent les astronomes ?
Pour répondre à cette question, les sociologues des sciences ont proposé le schéma de la rose des vents de la recherche. Celle-ci distingue 5 domaines dans lesquels la recherche scientifique est utile. Les sociologues des sciences représentent ces domaines par la rose des vents de la recherche.

1. Connaissances certifiées
Par leurs travaux de recherche, leurs observations, leurs travaux théoriques, les astronomes contribuent à notre connaissance de l’univers.
Guillaume Bigourdan, travailleur infatiguable, a été surnommé « le bénédictin de l’astronomie ». Il écrivit en moyenne un article scientifique par mois pendant 45 ans, soit environ 540 articles, ainsi qu’une vingtaine de monographies.
2. Compétences incorporées
Toutes les connaissances acquises par les scientifiques ne servent à rien si ceux-ci ne transmettent pas leur savoir-faire en même temps que leur savoir.
Les chercheurs forment des étudiants, des ingénieurs, qui ensuite utilisent leurs compétences dans la recherche fondamentales ou dans d’autres domaines, comme la recherche appliquée.
Guillaume Bigourdan était un travailleur solitaire, comme Albert Einstein. Ce dernier n’encadra qu’un seule étudiant en thèse dans toute sa carrière; quant à Guillaume Bigourdan, il n’eut aucun étudiant.
3. Innovations
L’astronomie contribue indirectement à la production d’innovations, parce que les astronomes ont besoin d’instruments extrêmement sensibles, fiables et précis. En produisant ces instruments à la demande des astronomes, les industriels acquièrent de nouveaux savoir-faires qu’ils peuvent ensuite appliquer à d’autres domaines.
Guillaume Bigourdan proposa plusieurs amélioration techniques des instruments astronomiques:
— une méthode pour rendre plus commode l’usage des équatoriaux.
— Une disposition qui permettrait l’usage de puissants objectifs dans les observations méridiennes.
— Un moyen de perfectionner la mesure micrométrique des petites distances angulaires célestes.
— Une disposition permettant de reproduire à distance et d’enregistrer les différences de déclinaison données par un micromètre à vis.
— Nouveau micromètre à double image, particulièrement approprié à la mesure des petits diamètres.
— Améliorations à apporter aux instruments méridiens.
— Un moyen de soustraire les horloges astronomiques à l’influence des variations de la pression atmosphérique.
— Principe d’une nouvelle lunette zénithale
— Une forme nouvelle de chercheur de comètes.
Guillaume Bigourdan proposa également une méthode ingénieuse pour utiliser la force des marées. Il s’agit de laisser la mer remplir un grand bassin artificiel à marée haute; en se vidant à marée basse, le bassin actionne une turbine qui produit de l’alectricité. C’est, 50 ans avant la lettre, le principe de l’usine maré-motrice de la Rance.
En tant que directeur du Bureau International de l’Heure (BIH), Guillaume Bigourdan eut à se préoccuper de la transmission des signaux radio à grande distance. Il proposa notamment un appareil pour l’envoi automatique des signaux horaires par télégraphie sans fil. Le BIH fut à l’origine d’inventions concernant la radio.
4. Prestige
L’astronomie peut contribuer au prestige de la France par ses découvertes. C’est la principale raison pour laquelle les pays occidentaux acceptent de financer des projets très couteux comme le Télescope Spatial de Hubble, ou le grand télescope européen au Chili (Very Large Telescope)
Guillaume Bigourdan contribua au prestige de son pays à l’étranger par son cataloque de nébuleuses, qui lui valu la médaille d’or de la Royal astronomical Society de Londres en 1919. Il reçut plusieurs autres distinctions étrangères pour son oeuvre scientifique.
5a. Expertise
L’expertise des astronomes est souvent mise à contribution pour tout ce qui est métrologie (mesure des distances et du temps, le calendrier). Par exemple, les compagnies d’assurances ont besoin de savoir s’il faisait jour au moment d’un accident. Les astronomes ont toujours fourni la seconde exacte aux horlogers, et l’Observatoire de Paris est à l’origine de l’horloge parlante.
Cette expertise est également mise à contribution pour tout ce qui concerne l’environnement, le problème du réchauffement global par effet de serre, etc.
Pendant les deux guerres mondiales, les astronomes ont contribué à l’effort de guerre par des calculs de balistique pour l’artillerie. Dans ce domaine, Guillaume Bigourdan étudia la propagation du bruit du canon à grande distance.
5b. Vulgarisation
La vulgarisation est un domaine où les astronomes excellent, et Guillaume Bigourdan a produit un grand nombre de livre de vulgarisation d’astronomie :
— L’astronomie, évolution des idées et des méthodes (1911)
— Petit atlas céleste, avec introduction sur les constellations et les moyens de les reconnaître (1915)
— Le climat de la France (1916)
— Histoire de l’astronomie d’observation et des observatoires en France (3 volumes, 1918)
— Traité de la construction des cadrans solaires (1922)