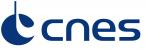Histoire du télescope Benjamin Baillaud
Emmanuel Davoust
Les instruments jouent toujours un rôle effacé, mais souvent crucial, dans l’évolution de nos connaissances en astronomie, et leur histoire mérite d’être contée. Celle du télescope Baillaud est exemplaire, car c’est grâce à lui que le Pic du Midi a pu acquérir sa réputation mondiale en planétologie, après qu’il eut été complètement transformé pendant la guerre par des hommes courageux et ingénieux.
Introduction
En 1900, Benjamin Baillaud, alors directeur de l’Observatoire de Toulouse, a en projet d’installer pour son établissement une station astronomique sur le plateau du Massegros, en Lozère. Mais, au moment où il va réaliser ce projet, le Recteur de l’Académie de Toulouse l’invite à le modifier, et à installer sa station au sommet du Pic du Midi, où le ciel est réputé d’une transparence exceptionnelle. Il y a déjà un Observatoire au sommet, depuis 1882, mais on y fait surtout des observations routinières de météorologie, et, pour l’astronomie, il n’est équipé que de petits instruments.
Benjamin Baillaud connait bien l’Observatoire du Pic du Midi pour avoir souvent participé à son inspection annuelle. Un point l’intrigue cependant, la contradiction apparente entre l’enthousiasme de Louis Thollon et Charles Trépied après leurs observations de 1883, et les médiocres images obtenues par Charles André et Emile Marchand sept ans plus tard. Il se souvient aussi de la désastreuse mission des frères Henry envoyés au Pic du Midi pour observer le transit de Vénus en novembre 1882; ils ne parvinrent même pas au sommet!
Pour en avoir le coeur net, il fait installer un petit télescope multi- fonctions sous une coupole provisoire au Pic du Midi pendant l’été 1901, et y passe de longues nuits à étudier la qualité du site, en alternance avec Henri Bourget, en octobre 1901 et de juillet à septembre 1902. Ces brefs séjours les amènent à conclure que les images médiocres n’existent pas au Pic. Soit le temps permet d’observer, et elles sont excellentes, soit il fait trop mauvais pour travailler, et il n’y a plus d’images.
Le projet de station astronomique à l’Observatoire du Pic du Midi commence à se concrétiser en 1904; le télescope est fabriqué par Paul Gautier, le constructeur d’instruments d’astronomie, et un détachement d’artilleurs d’un régiment de Tarbes met deux étés, ceux de 1906 et 1907, pour le transporter en pièces détachées dans 22 caisses de 350 à 700 kilos au sommet du Pic du Midi. Lelièvre, l’ouvrier de Gautier, passe les étés de 1908 et 1909 à terminer l’installation, et le télescope devient opérationnel en 1909. Il comporte deux tubes rectangulaires de 6m de long accollés, l’un pour un télescope à miroir de 50 cm, l’autre pour une lunette visuelle à lentilles de 23 cm. Ce télescope est ouvert aux savants de tous les Observatoires français et étrangers.
Les premiers utilisateurs du télescope
Jules et René Baillaud, les deux fils astronomes de Benjamin Baillaud, font les premiers essais sur le nouveau télescope en août 1909, puis c’est le tour du comte Aymar de la Baume Pluvinel, astronome libre, et de son assistant, Fernand Baldet. Dès son arrivée au début de septembre 1909, ce dernier est absolument fasciné par le ciel du Pic. « Le ciel se découvre brusquement et j’ai devant les yeux le spectacle le plus inimaginable qu’un astronome puisse rêver. La Voie Lactée est étincelante, les étoiles brillent comme des phares. Le ciel est blanc d’étoiles et leur éclat est suffisant pour éclairer les nuages qui sont à nos pieds. »
Vers la fin de sa mission, il écrit à ses parents: « J’ai vu hier au soir Mars comme un dessin tellement il était calme. On distinguait les canaux comme s’ils avaient été dessinés à la plume. »
Ses photos de Mars sont d’une telle finesse de détail qu’il peut démentir l’existence d’un réseau de canaux fins aux formes géométriques que Percival Lowell donnait comme preuve de l’existence d’êtres intelligents sur la planète rouge.
Ce premier succès encourage le comte de la Baume Pluvinel à financer une deuxième mission à l’automne de l’année suivante. Mais, entre temps, il y a le retour de la comète de Halley.
Au début du mois de mai 1910, Henri Godard et Gaston Millochau montent au Pic du Midi pour observer la comète de Halley; ils resteront presque trois semaines à attendre le beau temps. Comme l’écrit Henri Godard à son directeur, Luc Picart, le temps est long. « Parfois pour nous distraire nous faisons une partie de cartes ou une partie de jacquet. Les grands soirs nous avons une audition de phonographe (10 morceaux au choix, j’ai déjà entendu chacun d’eux quatre ou cinq fois). »
Enfin, le 21 mai, une éclaircie. « j’ai pu apercevoir la comète à l’oeil nu dans une éclaircie à 8h45; malgré le crépuscule la lune et les nuages, elle était très belle, malheureusement elle était trop près de l’horizon pour que l’on puisse la photographier. Depuis, nous sommes constamment dans le brouillard et parfois il neige; c’est une malchance extraordinaire. »
La deuxième mission de Fernand Baldet, en septembre-octobre 1910, est, elle aussi, décevante. Son bilan est de 43 photos de Saturne et de ses satellites, et de 20 belles nuits sur 48, alors que l’année précédente il avait pris plus de 500 photos de Mars. Aymar de la Baume Pluvinel écrit un peu plus tard à Emile Marchand, le directeur de l’Observatoire du Pic du Midi, que le séjour de son assistant a été bien peu fructueux. « Vous aviez raison de modérer l’enthousiasme des astronomes sur le beau temps du Pic. En somme, la nébulosité et à peu à peu près la même qu’à Paris; mais, lorsque le ciel est découvert, on a l’avantage d’avoir une atmosphère très stable et très transparente. »
La réputation du Pic
Ces deux missions marquées par le mauvais temps, auxquelles fait écho celle des frères Henry en 1882, ont sans doute fait au site une réputation qu’il ne mérite pas, mais qui sera malheureusement tenace. Les résultats exceptionnels de Baldet sur Mars en 1909 sont vite oubliés, ainsi que les conclusions élogieuses des études du site par Thollon et Trépied en 1883, puis par Baillaud et Bourget en 1901-1902.
Il est vrai que d’autres raisons contribueront à ce que le Pic du Midi ne soit pas très fréquenté. Il y a tout de même l’inconfort de la vie quotidienne au sommet. Benjamin Baillaud est bien conscient de ce problème. « Il serait sans doute impossible de trouver un savant sérieux qui consentit à résider ordinairement au sommet du Pic » , confie-t-il lorsqu’il soumet son projet au ministère en 1903.
Benjamin Baillaud quitte Toulouse en 1908 pour prendre la direction de l’Observatoire de Paris, sans avoir introduit de tache de service autour d’un programme scientifique pour ce nouveau télescope. Son successeur à l’Observatoire de Toulouse, Eugène Cosserat, est plus mathématicien qu’astronome; il se désintéresse de l’instrument et donne la priorité au dépouillement des clichés de la Carte du Ciel. Résultat, pendant les 40 premières années de son existence, le télescope Baillaud ne verra que trois fois des astronomes toulousains, Emile Rabioulle et Frédéric Rossard en août 1911, et Emile Paloque en août 1927 et 1928.
Le personnel permanent au sommet du Pic du Midi n’utilise pas non plus ce télescope. Emile Marchand considéra toujours la station astronomique de Toulouse comme une intrusion sur son fief, et Sylvain Latreille, l’aide-météorologiste chargé des observations astronomiques, continua à utiliser sa petite lunette pour cartographier les taches solaires.
Autre problème, le télescope Baillaud n’est commodément utilisable qu’entre la mi-juillet et la fin octobre de chaque année, lorsque les conditions d’accès au sommet du Pic du Midi ne sont pas trop difficiles et que la coupole n’est pas bloquée par la neige et le givre, ou envahie par la neige volante. De ce fait, le télescope n’est jamais utilisé en hiver. Au début de chaque saison, Emile Cazabon, le mécanicien de l’Observatoire de Toulouse, est chargé de remonter les pièces mises à l’abri en hiver et de remettre le télescope en état de fonctionner.
Jules Baillaud, retrouvant le télescope en très mauvais état et le barillet du miroir tout rouillé lors de son retour au sommet en août 1921, remarque, dans une lettre à son père que « la mise en état par Cazabon avait été très fictive. » Trois semaines plus tard, il écrit « quant à Cazabon et à l’Obs. de Toulouse, je pense qu’ils se désintéressent de l’équatorial. Il n’y a que l’Obs. de Paris qui puisse le faire marcher. »
Et, en effet, Jules Baillaud est le seul astronome qui utilise régulièrement le télescope. Entre 1909 et 1931, il passe huit étés au Pic du Midi, soit un total d’environ dix mois. Si les résultats scientifiques ne semblent pas à la hauteur du temps passé au sommet, il y a des circonstances atténuantes: « Ceux qui jugeront mon travail ici ne se rendront pas compte de la peine et du temps nécessités simplement par des accessoires » , écrit-il à son père en 1921. Il reçoit cependant le Prix Lalande de l’Académie des Sciences en 1924 pour ses travaux de spectrophotométrie stellaire réalisés au Pic du Midi. Mais ces travaux n’améliorent pas la réputation du site, dont les qualités exceptionnelles profitent plus à l’imagerie qu’à la spectroscopie.
Un télescope à problèmes
Le télescope lui-même n’est pas parfait. Il est équipé d’un miroir de médiocre qualité, affecté d’astigmatisme. Lors de sa première mission en 1909, Fernand Baldet ne trouve cependant pas de défauts bien sensibles au miroir, il y aperçoit tout au plus très faiblement les coups de poli. La lunette de guidage de 23 cm accollée au télescope donne de meilleures images. « Si on avait un dessin à faire, c’est à la lunette que nous l’aurions fait » , note Fernand Baldet dans son cahier de coupole en 1909.
Le télescope pose aussi quelques problèmes pratiques. Il est très malcommode d’observer à l’oculaire du télescope. Jules Baillaud se souviendra plus tard que l’observateur doit se mettre « contre l’ouverture de la trappe, dans un courant d’air souvent violent, situation qui devient extrêmement pénible et dangereuse lorsque les poses se prolongent aux basses températures qui régnent au Pic; un malaise, une chute, précipiteraient l’observateur dans le vide, hors de la coupole. » Il faut faire les poses en guidant avec la petite lunette.
Quelques modifications du télescope et de sa coupole sont apportées au cours des années, qui améliorent le confort des observateurs. Au début, la trappe de la coupole se maneuvre à la main; Baldet raconte qu’il fallut la fermer précipitamment un soir d’orage en 1909 : « plus de 530 tours de manivelle partagés avec M de la Baume, à raison de 100 tours chacun alternativement. » A partir de septembre 1926, la rotation de la coupole et la fermeture de la trappe se font grâce à des moteurs électriques. Au début des années 30, Bernard Lyot remplace le régulateur de Foucault du télescope par un moteur électrique de … phonographe!
Un tournant dans le vie du Pic
Camille Dauzère, nommé directeur en 1920, oriente résolument l’Observatoire vers la géophysique, en partie pour assurer la survie d’un établissement dont se désintéresse la communauté astronomique française. Mais plusieurs événements vont contribuer à ramener l’astronomie au premier plan des activités de l’Observatoire.
Lorsque Joseph Devaux, géophysicien au Pic du Midi, disparait tragiquement dans le naufrage du Pourquoi-Pas? en septembre 1936, c’est un astronome qui est nommé pour le remplacer. Henri Camichel a été stagiaire à l’Observatoire de Meudon pendant plusieurs années, c’est un utilisateur chevronné de la grande lunette de 83 cm de Meudon, et il est bien résolu à faire de l’astronomie au Pic du Midi. « Quand je suis arrivé au sommet en décembre 1936, Hubert Garrigue était le seul physicien à l’Observatoire depuis deux mois. Au premier repas, il me dit que je ne peux pas faire d’astronomie. « Allez voir la coupole, elle est remplie de neige et ne va pas tourner. » Je suis allé voir la coupole; elle était en effet pleine de neige, qu’il a d’abord fallu déblayer. La coupole se maneuvrait soit à la main avec un volant, soit par un moteur. Fourcade [l’homme de service] s’est mis au volant, moi-même j’ai fait marcher le moteur, et la coupole a bien voulu tourner. »
L’été suivant, Camichel fait placer un système pour couper le vent qui passait sous la coupole et y apportait la neige : une lame solidaire de la coupole et plongeant dans une rigole circulaire posée sur le mur de la coupole. « En principe, la rigole devait être remplie de glycérine. Du mercure aurait été mieux, mais c’était trop cher. La glycérine, emportée par le vent, n’est pas restée, mais l’expérience a montré qu’elle n’était pas nécessaire; la chicane formée par la lame et la rigole suffisait pour couper le vent et la neige volante. »
Le deuxième événement est le départ à la retraite de Camille Dauzère en 1937. Les quelques jeunes scientifiques susceptibles de prendre la relève, Bernard Lyot, Daniel Chalonge et Alexandre Dauvillier, déclinent l’offre. Devant la menace du Ministère de fermer le Pic si aucun directeur n’est nommé, Jules Baillaud accepte à contre-coeur cette responsabilité. « en sacrifiant une part de mes travaux, je pourrais bien aller passer quelques jours à Bagnères tous les mois et y passer les trois mois d’été. » Deux ans plus tard éclate la guerre, puis c’est l’exode de 1940, et Jules Baillaud s’installe définitivement à Bagnères.
Les observations de Mars au Pic
Le télescope Baillaud est utilisé avec succès par Bernard Lyot, Henri Camichel et Marcel Gentili pour observer l’opposition de la planète Mars de 1939; malgré les mauvaises conditions de cette opposition, très basse sur l’horizon, les images sont remarquables. Jules Baillaud est désormais convaincu qu’il faut organiser au Pic l’observation systématique des surfaces planétaires, et, malgré la guerre, il poursuit activement un ambitieux projet de rénovation de l’instrumentation au Pic du Midi démarré en 1936. En parallèle avec l’étude de deux nouveaux télescopes, il entreprend la rénovation du télescope Baillaud, et veut remplacer le miroir de 50cm par un grand objectif à lentilles.
Le premier grand objectif auquel il pense est celui de René Jarry-Desloges, un astronome amateur qui s’est construit un Observatoire à Sétif, en Algérie. Son objectif de 50cm reste inutilisé à Paris, mais il est hostile à l’idée de le prêter, à cause de de sa grande valeur, et parce que c’est un objectif visuel, donc mal adapté à la photographie. (Il se trompe, il suffit d’utiliser des plaques panchromatiques). Par ailleurs, il n’est pas favorable aux observatoires de montagne, car les essais qu’il a faits au Revard (en Savoie) lui ont donnés de très mauvais résultats.
L’imminence de l’opposition suivante de Mars, en 1941, oblige les astronomes du Pic à trouver une solution rapidement. Bernard Lyot obtient que l’Observatoire de Toulouse lui prête l’excellent objectif de 38cm fabriqué par les frères Henry, mais avec promesse de le redescendre avant l’hiver. Henri Camichel peut ainsi commencer une série de photos de Mars le 12 septembre 1941, grâce à des plaques apportées par Lyot pour l’observation de la couronne solaire et procurées par un astronome allemand, Kippenheuer, alors officier dans la Wehrmacht.
L’objectif devra redescendre avant la fin de l’opposition. Mais les résultats de cette campagne d’observation sont aussi bons que ceux de 1939, écrit Bernard Lyot le 22 mai 1942. « J’ai présenté dimanche dernier à la Société astronomique nos observations planétaires de 1941. Les clichés de Camichel sont vraiment merveilleux. Ils ont encore gagné par un tirage approprié. » L’objectif est à nouveau au Pic pendant l’été 1942, où il sert jusqu’au 9 octobre.
Transformation du télescope Baillaud
En 1942, le grand coudé de l’Observatoire de Paris, bien connu pour les photographies de la lune prises par Pierre Puiseux et Maurice Loewy entre 1893 et 1910, ne sert plus depuis longtemps, et Ernest Esclangon ne voit pas d’inconvénient à prêter l’un des deux objectifs de 60cm de diamètre( Ce sera l’objectif visuel, et non le photographique à l’Observatoire du Pic du Midi).
Mais le projet d’installer cet objectif au télescope Baillaud n’est pas simple. En effet, il a une longueur focale de 18m, alors que le tube du télescope Baillaud n’a que 6m de longueur. Il faut donc enlever la paroi entre les deux tubes du télescope Baillaud, et replier deux fois le faisceau lumineux dans l’espace libéré, avec deux miroirs, si l’on veut qu’il y ait 18m entre l’objectif et l’oculaire. Il s’agit en fait de construire une toute nouvelle lunette, en ne conservant que l’armature métallique extérieure du télescope.
Ce genre de télescope a déjà été envisagé, c’est ce qu’on appelle un réfracto-réflecteur de Schaer. Ce montage optique permet un tube trois fois moins long, donc moins de flexions, et surtout moins d’irrégularités de température dans les couches d’air traversées, et donc de meilleures images, au prix d’une diminution de luminosité d’environ 20% (à cause des deux réflexions). Les réflexions se font sous une incidence presque normale, ce qui réduit les effets d’astigmatisme.
Les difficultés d’une telle entreprise, surtout dans le contexte de 1942, sont considérables. Tout d’abord, la construction de tout instrument d’astronomie est interdite par les répartiteurs des métaux ferreux et non ferreux. Il faut donc demander une dérogation au Comité d’Organisation des Instruments de Précision, à Lyon. Ensuite, il faut pouvoir enlever la paroi entre les deux tubes sans compromettre la rigidité de l’ensemble, trouver deux miroirs, concevoir et faire fabriquer des barillets pour maintenir en place chacune des trois pièces d’optique, et, une fois tout en place, arriver à centrer simultanément l’objectif et les deux miroirs dans la monture.
C’est sur l’espace limité de cartes postales interzones que Bernard Lyot doit discuter avec Jules Baillaud de la conception des nouveaux barillets, avec dessins à l’appui. Pour la réalisation des pièces, Jules Baillaud s’adresse aux établissements Beaudouin, l’un des rares industriels spécialisés en zone libre, où travaille son fils Pierre. La commande est envoyée à Roanne le 14 mai : deux barillets destinés aux deux miroirs, avec possibilité de réglage de l’inclinaison des miroirs, un barillet pour l’objectif, deux platines destinées à recevoir les différentes pièces aux deux bouts du tube du télescope, et une culasse porte-oculaire porte-plaque. Les diverses solutions techniques élaborées avec Lyot sont détaillées dans un rapport annexé à la commande.
Bernard Lyot monte au Pic du Midi au début de l’été; il peut alors discuter plus commodément avec Jules Baillaud des études en cours de réalisation, que tous deux suivent attentivement, transmettant au fur et à mesure leurs critiques et suggestions à Roanne. Les modèles de fonderie pour les pièces sont prêts à la mi-août, mais la difficulté de se faire livrer de l’aluminium retarde la fabrication et l’usinage jusqu’à la fin octobre.
Le 11 novembre 1942, les allemands envahissent la zone libre, et les difficultés pratiques que Jules Baillaud doit affronter vont se décupler. Deux semaines plus tard, il écrit à Paul Beaudouin, « Il faut faire un effort sur soi-même pour proposer des entreprises comme celles qui s’attachent au Pic du Midi quand on est accablé par toutes les perturbations qui frappent notre pays et qu’on ne voit plus bien clair dans son avenir. Cependant le devoir d’agir subsistera, chacun à sa tâche, même si cette tâche paraissait et devait être vaine. »
Les problèmes de communication et de transport entre Bagnères et Roanne vont devenir très aigus. Toutes les pièces pour le télescope Baillaud sont achevées, mais la SNCF n’accepte plus le transport de colis de plus de 20 kilos sans autorisation spéciale de transport, et les transports routiers sont complètement désorganisés.
Les pièces sont finalement toutes au sommet fin janvier 1943, et l’ingénieur Tauziet, des établissements Beaudouin, les installe sur le télescope Baillaud dans la première semaine de février 1943. Le 14 février, Camichel monte l’objectif sur le tube du télescope Baillaud avec l’aide de Carmouze, le cuisinier. Et, inévitablement, surgissent les défauts de jeunesse du nouveau télescope, auxquels on remédie au fur et à mesure qu’ils sont identifiés.
Le problème le plus sérieux est que la qualité optique de la lunette ainsi constituée n’est pas satisfaisante. Lorsque Lyot remonte au Pic au mois de mai, il installe un banc optique de fortune et constate avec Camichel que les miroirs sont défectueux. Ils sont renvoyés au laboratoire d’André Couder à Paris pour être repolis. En attendant leur retour, Jules Baillaud obtient à nouveau l’objectif de 38cm en prêt au mois d’août 1943. Emile Paloque consent à le laisser au Pic pour l’année, jugeant qu’il y sera mieux à l’abri des bombardements. Il y restera jusqu’en octobre 1944.
Les deux miroirs du coudé sont de retour au Pic fin novembre, et Henri Camichel peut observer avec le télescope rénové dès le début de décembre 1943.
La nouvelle lunette Baillaud
Cette nouvelle lunette va servir de façon intensive pendant près de vingt-cinq ans. Au début, elle est d’un usage délicat, à cause du poids supplémentaire de l’objectif et des deux miroirs. Mais, grâce à l’ingéniosité d’Henri Camichel, la lunette devient avec le temps de plus en plus maniable et facile d’emploi.
Laissons à Audouin Dollfus, l’un des utilisateurs les plus assidus de cette nouvelle lunette, le soin d’en faire le bilan. « Si je médite, avec le recul, sur cette lunette de 60cm (…), je vois l’exemple d’un instrument admirablement exploité par des hommes de grand talent, venus du monde entier, un français, Henri Camichel, un grec, Jean Focas, un italien, Glauco De Mottoni, des anglais, Edward Bowell et John Murray. Ce dernier a réalisé un planisphère de Mercure, et étudié la configuration des taches à la surface des satellites de Jupiter. Camichel, Focas et moi-même avons mesuré des diamètres de planètes au millième près; il a fallu les recherches spatiales pour faire mieux, et leurs mesures sont toujours tombé dans nos barres d’erreurs. Dans ma carrière d’astronome, je considère que cette opération de la lunette de 60cm du Pic a été une belle et grande chose. »
La lunette Baillaud ne sera détrônée qu’en 1963, par un télescope à miroir de 1m de diamètre. L’objectif du grand coudé de l’Observatoire de Paris resta installé sur la lunette Baillaud jusqu’en 1965, lorsque Jean Rösch le fit démonter pour y installer un nouveau coronographe.
Emmanuel Davoust